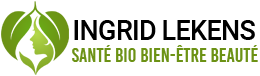Des branches de la médecine les plus régulièrement citées ces dernières années, figure l'ostéopathie. Sa définition n’a pu faire objet de consensus, à l'image de la médecine elle-même dont elle relève. En dépit de sa série de définitions selon les différentes approches, thérapeutique, épistémologique, etc, le référentiel des métiers de France la définit comme consistant, « dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d’en altérer l’état de santé ». Nous allons à travers cet article, découvrir l'essentiel de ce que nous savons ou ignorons peut-être de l'ostéopathie, et qui peut nous sauver la vie ou celle d'un proche après une bonne consultation.
Que soigne un médecin ostéopathe ?
Le "medecin osteopathe" aide à guérir différents types de douleurs : locales, chroniques, irradiées. Ces douleurs quelles qu’elles soient, témoignent très souvent du mauvais fonctionnement général ou localisé de l'organisme humain. Lorsque le corps humain est constamment exposé à différents facteurs de stress, des problèmes de santé, douleurs chroniques et séquelles de traumatismes peuvent faire leur apparition. Le médecin ostéopathe, par son approche globale, a reçu une formation et est apte à prévenir ces situations, mais peut également, en situation de crise, aider le corps à retrouver son équilibre par des thérapies manuelles. Il peut aider l'organisme à atténuer des troubles et symptômes touchant les différents systèmes : musclo-squelletique, génito-urinaire, digestif, vasculaire, nerveux et oto-rhino-laryngologiste.
Quand consulter un medecin osthéopathe ?
Le médecin généraliste ostéopathe est en mesure d’exercer des manipulations thérapeutiques efficaces et agir aussi en prévention. Les patients de tous âges, y compris les jeunes enfants, devraient effectuer une consultation lorsque leurs maux relèvent des trois (3) domaines majeurs suivants : le domaine pariétal, le domaine viscéral et le domaine crânien. En cas de :
- douleurs chroniques ou intermittentes persistantes ;
- surcharge affective ou traumatique (subie ou à venir) ;
- inconfort causé par une chirurgie récente ;
- coliques et douleurs d'après accouchement ;
- dysfonction du plancher pelvien ;
- début d’arthrose, tendinite, blocages articulaires ;
- perte de flexibilité ou de mobilité ;
- dysphagie, infections urinaires, vertige, otite et bronchite ;
- hernie discale ;
- performances physiques à améliorer ;
- besoins de récupération post-pastum ou des cicatrices de césarienne, il ne faut pas hésiter à consulter l'ostéopathe.
Comment se déroule une séance d'ostéopathie ?
La consultation d'ostéopathie dure en moyenne 45 minutes L'ostéopathe commence toujours par un entretien et un examen de l'ensemble du corps par des palpations, comme le spécialiste l'a assimilé en formation. Il procède ensuite à des manipulations, avec ses mains, mais aussi parfois avec le reste de son corps, par exemple en s'appuyant contre le dos de la personne qu'il manipule. Quatre formes de manipulations peuvent être effectuées lors d'une telle consultation :
• les manipulations fonctionnelles, dont l'objectif est une mobilisation des tissus pour provoquer une détente suffisante permettant à une lésion de se soigner d'elle-même ;
• les manipulations viscérales, pour rendre leur pleine efficacité au foie, à la rate, aux ; intestins, etc. ;
• les manipulations structurelles, lorsque l'ostéopathe appuie à certains endroits pour libérer notamment des points de blocage ;
• enfin, les manipulations crâniennes, les plus délicates et les plus fines, qui agissent sur les os du crâne pour lui redonner souplesse et améliorer la respiration. Pour disposer de ces aptitudes, il faut étudier la profession à travers une formation dans une école et pourquoi pas à paris.
Comment devenir ostéopathe en France ?
Formé à l'ostéopathie, l’ostéopathe est un professionnel dont l'activité est soumise et encadrée par des textes de lois. La formation des ostéopathes en France, surtout à paris est très hétérogène. Néanmoins, la loi du 4 mars 2002 (modifiée en avril 2011), autorise l'usage du titre d'ostéopathe non seulement aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers, titulaires d'un diplôme universitaire (DU) ou d'un diplôme interuniversitaire (DIU) reconnu par l'Ordre des médecins, mais aussi aux non professionnels de santé titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé par le ministère de la Santé. Il existe trois sortes de formations en France. La première s'adresse aux médecins et est reconnue par le Conseil national de l'ordre des médecins. La seconde s'adresse aux professionnels de la santé, notamment les kinésithérapeutes, et est réalisée en alternance. La dernière est accessible aux bacheliers, après concours et entretien, et dure 6 ans avec à l'issue, une inscription au registre des Ostéopathes de France à paris. En janvier 2013, sur les 19 369 ostéopathes recensés par le Registre des ostéopathes de France, 55,4 % d'entre eux ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes. Ce n’est pas une raison pour s’incliner à tout prestataire ostéopathe. Il est préférable de toujours opter pour un ostéopathe professionnel et diplômé, répertorié sur le site de l'Union Fédérale des Ostéopathes de France (UFOF) et sur recommandation de son médecin traitant ou d'un médecin spécialiste en fonction de la pathologie à traiter. Le secteur de la "medecine" d'ostéopathie devient de plus en plus saturé. Alors les patients se doivent de prendre des précautions relatives au choix du praticien. Les ostéopathes diplômés indiquent en principe, sur leur plaque, la mention "DO" qui signifie diplômé(e) en ostéopathie. Pour financer leurs études, de nombreux étudiants choisissent chaque année d’effectuer un prêt bancaire. Les écoles d’ostéopathie en France bénéficient d’accords préférentiels auprès de certaines banques. Alors en choisissant l’ESO Paris pour suivre une formation, l'étudiant peut bénéficier d’accords privilégiés avec certaines banques partenaires qui offrent des conditions favorables et des possibilités de remboursement différé jusqu’à 18 mois après le diplôme.